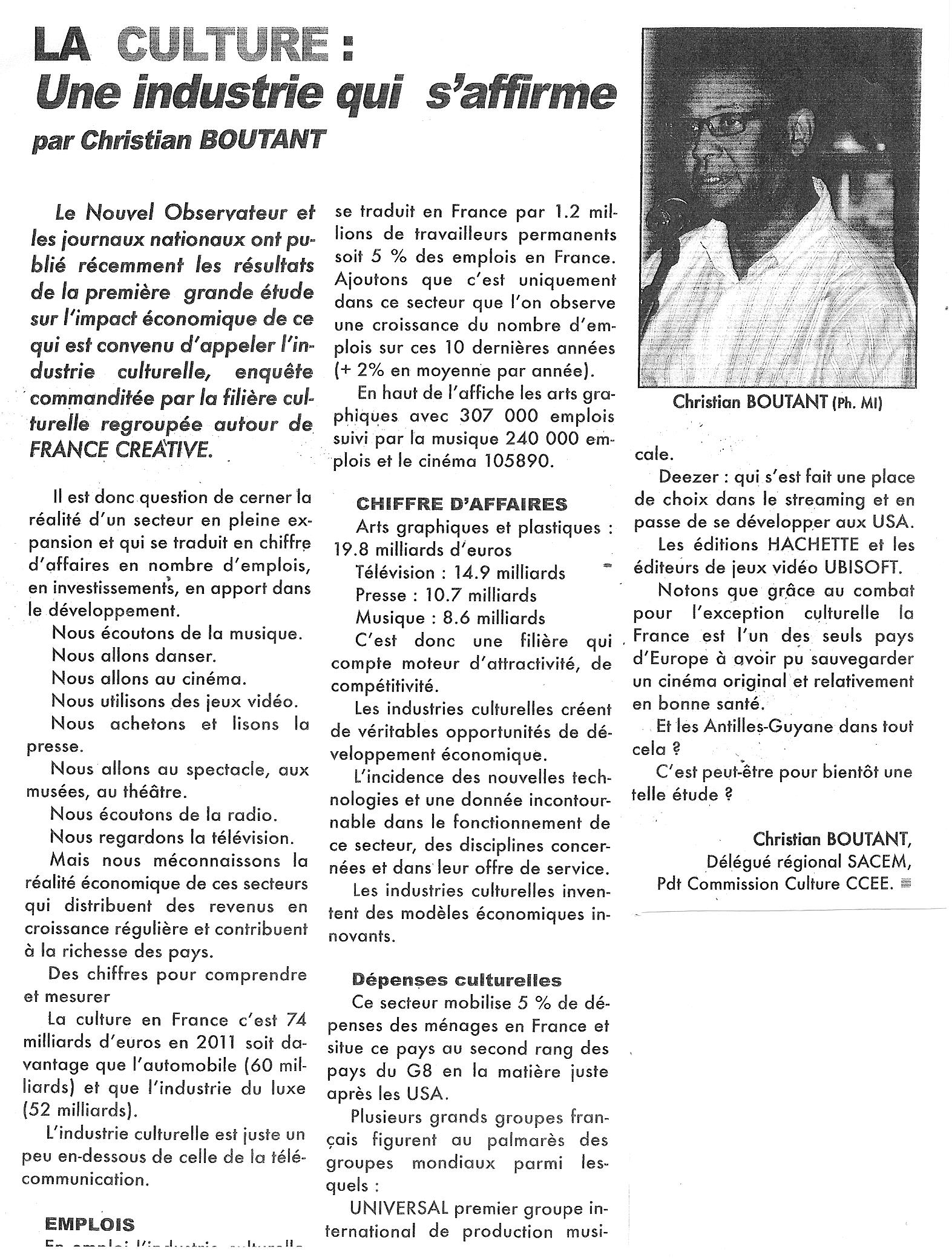Archives pour la catégorie Sujets de réflexion
EXHIBIT B : Quiproquo ou analyseur ( Saïd Bouamama).
Publié le 18 décembre 2014 par Said Bouamama
La performance de l’artiste sud-africain Brett Bailley intitulée Exhibit B est l’objet depuis plusieurs semaines d’une forte polémique. Une œuvre présentée par l’artiste et ses soutiens comme « antiraciste » est condamnée comme « racisme déguisé » par plusieurs associations et les milliers de signataires de la pétition réclamant la déprogrammation du spectacle. Les défenseurs du spectacle argumentent en termes de « liberté d’expression artistique » et de « quiproquo » sur le message. Ses opposants dénoncent une « chosification des victimes » ne pouvant que reproduire, même involontairement, les représentations sociales racistes. Les défenseurs dénoncent même « un procès d’intention à l’artiste au motif qu’il est blanc ». Loin d’être selon nous un simple quiproquo et encore moins un procès d’intention, la polémique est un analyseur des contradictions du mouvement se réclamant de l’antiracisme.
Le racisme est un rapport social
Comme toutes les exploitations et les dominations, le racisme n’est pas un objet mais un rapport social. Analysant le capital, Marx souligne que « Le capital est non un objet, mais un rapport social de la production, adéquat à une forme historiquement déterminée de la société et représenté par un objet, auquel il communique un caractère social spécifique[v] ». Un rapport social ne décrit pas une simple relation entre deux groupes sociaux, il relie ces interactions entre groupes à une surdétermination systémique hiérarchisante. C’est cette dimension systémique qui produit à la fois l’exploiteur et l’exploité, le dominant et le dominé, le raciste et le racisé infériorisé.
Elle tend également à produire l’intériorisation du rapport chez les uns comme chez les autres. Nous parlons de tendance parce que, bien entendu, des contre-tendances existent inévitablement du côté du dominé. Si la forme des résistances du dominé peuvent être multiples, elles existent inévitablement : soumission apparente, valorisation de ce qui est déprécié par le dominant, ironie et humour, repli sur soi et fuite du dominant, résistance organisée pacifique ou violente, etc. Avec leurs sens de la formule, Mao et Mandela résument comme suit ce constat : « partout où il y a oppression il y a résistance » et « C’est toujours l’oppresseur, non l’opprimé, qui détermine la forme de la lutte ».
Cette approche matérialiste du racisme s’oppose aux versions idéalistes multiples : le racisme comme méconnaissance de l’autre, le racisme comme peur de l’inconnu, le racisme comme virus importé, le racisme comme simple héritage du passé, etc. En ne reliant pas le racisme à la société qui le produit quotidiennement, ces approches idéalistes débouchent sur un antiracisme moral et moralisant se proposant de « changer les mentalités » sans remettre en cause le système social lié à ces « mentalités ». Frantz Fanon a parfaitement résumé l’approche matérialiste du racisme et sa différence avec les versions idéalistes : « La réalité est qu’un pays colonial est un pays raciste. Si en Angleterre, en Belgique ou en France, en dépit des principes démocratiques affirmés par ces nations respectives, il se trouve encore des racistes, ce sont ces racistes qui, contre l’ensemble du pays, ont raison. Il n’est pas possible d’asservir des hommes sans logiquement les inférioriser de part en part. Et le racisme n’est que l’explication émotionnelle, affective, quelquefois intellectuelle de cette infériorisation […] Le racisme n’est donc pas une constante de l’esprit humain. Il est, nous l’avons vu, une disposition inscrite dans un système donné »
Ces propos de Fanon n’ont pas vieilli dans la mesure où la France reste un État colonial, encore plus un État néocolonial, intervenant militairement dans plusieurs de ses anciennes colonies, structuré par des discriminations racistes massives et structurelles touchant les descendants de son ancien empire. Ce contexte global mène légitimement à une méfiance lorsque le racisme est abordé, décrit, exposé, mis en scène, chanté, etc., sans intégrer les résistances qu’il a suscitées, les réactions de refus qu’il a provoquées, les révoltes qui lui ont répondu.
Que peut en effet produire l’exposition d’une domination (surtout avec la qualité artistique dont nous ne doutons pas) sans les réactions des dominés ? De la commisération, de la pitié, de l’émotion, etc., c’est-à-dire exactement l’inverse de ce dont ont besoin ceux qui sont par leur histoire ou leur présent connectés à cette domination. Pour eux, le besoin n’est pas la pitié mais l’égalité, il n’est pas la commisération mais la dignité. Sans remettre en cause la sincérité de la profession de foi antiraciste de l’auteur, il faut s’interroger sur la distance (sociale, politique, émotive, etc.) qu’elle révèle entre lui et ceux qui subissent encore aujourd’hui le racisme. Plus largement, la polémique en cours à propos de cette performance est un analyseur de la distance entre les grandes organisations antiracistes et ceux qui subissent quotidiennement ce rapport de domination, rapport qui se traduit quotidiennement en inégalités, discriminations et humiliations.
Objet parlé ou sujet parlant ?
La polémique actuelle n’est pas nouvelle. Ce qui est peut être nouveau, c’est qu’elle s’exprime à propos d’une expression artistique. Les polémiques du début de la décennie 80 entre les « marches pour l’égalité » et le mouvement SOS Racisme étaient de même nature[ix]. Aujourd’hui comme hier la question est celle du statut du groupe social : objet parlé ou sujet parlant ? Il est vrai qu’à l’époque également le soutien aux tenants de « Touche pas à mon pote » a été massif à gauche, alors qu’il suscitait la colère des quartiers populaires.
La question n’est ni secondaire, ni dépassée pour des raisons politiques essentielles. En premier lieu, l’élimination (volontaire ou non, le résultat est identique) de la parole des premiers concernés ne peut pas ne pas rappeler le processus de chosification au cœur du rapport raciste en général, du rapport esclavagiste et colonial plus particulièrement. Ce n’est pas un hasard si Césaire dans son discours sur le colonialisme parle autant des sens : « je vois », « j’entends », « je parle », etc. C’est que toutes les dominations nécessitent une disparition de l’expression des dominés, de la prise en compte de ce qu’ils voient, entendent, ressentent, etc. Ce n’est pas pour rien non plus que l’émancipation s’accompagne d’une prise de parole, d’une sortie de l’invisibilité, d’une affirmation de ce qui est vécu et invisibilisé. Abordant cette négation du « sujet parlant », l’historienne Marie Rodet nous donne la description suivante de l’ethnographie coloniale : « La différence fondamentale posée par le colonisateur/ethnographe face à l’Africain est la suivante : le premier écrit sur, tandis que l’Africain est écrit par ; pour ce dernier, le rôle assigné est la passivité tandis que le premier détient le pouvoir d’observer, d’étudier[x]. »
Comment s’étonner dès lors des réactions à Exhibit B en Angleterre comme en France, comme partout où il y aura des descendants de l’esclavage et de la colonisation ? Ce qui est plutôt étonnant, c’est l’absence d’anticipation de ces réactions. Ce qui est surprenant, c’est leur invalidation en parlant de quiproquo, d’attitudes de censeurs qui n’ont même pas vu le spectacle, de jugement sur le simple fait que l’artiste est « blanc », etc.
En second lieu, la logique de prise en compte des racisés comme « objets parlés » et non comme « sujets parlant » ne peut qu’être productrice d’une cécité sur le monde social. La perception de la réalité qui élimine la subjectivité des dominés ne peut pas percevoir et même pas s’approcher de l’ordre des priorités qui s’imposent à eux. Comment prétendre parler de l’oppression sexiste si l’on est un homme et que l’on ne se pose pas la question de notre détermination sociale comme homme ? Comment prétendre prendre en compte la domination raciste si l’on est un blanc et que l’on ne se pose même pas la question de notre détermination sociale comme membre du groupe « majoritaire » ? Comment penser pouvoir restituer l’exploitation ouvrière, si l’on appartient aux couches moyennes et que l’on ne se pose même pas la question de notre détermination de classe ?
Prévenons deux faux débats. Nous ne pensons pas que la lutte antiraciste ne soit possible que menée par les racisés, que la lutte antisexiste ne soit possible que menée par les femmes ou que la lutte anticapitaliste ne soit possible que menée par les ouvriers. Nous disons simplement que la lutte anticapitaliste n’est pas possible sans les ouvriers, etc. Nous disons également que les prises de position, les analyses, les priorités, etc., doivent se donner les moyens d’une confrontation avec la subjectivité des dominés. Le second faux débat est celui de la véracité du point de vue des dominés. Nous ne pensons pas que le simple fait d’être dominé suffit, en lui-même, à la compréhension du rapport de domination. Mais dire cette banalité ne signifie pas nier que l’expérience d’une domination est un facteur (certes parmi d’autres) de la conscience politique.
Toute présentation du dominé qui n’intègre pas sa révolte contre la domination qu’il subit contribue à le chosifier, à le construire comme passif, à le déshumaniser. Les cartes postales de l’époque coloniale étaient emplies de ces clichés où le colonisé miséreux supportait son sort avec fatalité. L’orientalisme en fera un de ses leitmotivs essentiels. Volontairement ou non, ce qui se révèle ici est une perception de l’autre passif et soumis. Or cette perception est l’antichambre d’une autre : celle du dominé consentant à sa domination.
Le fraternalisme
Encore une fois, nous ne nions pas la sincérité antiraciste de l’artiste mais cela ne peut pas clore le débat. Le propre d’une domination est de ne pas apparaître comme telle aux yeux même du dominant. On peut bien sûr être raciste sans le savoir, sans le vouloir et même en étant persuadé de ne pas l’être. C’est une des premières choses qu’apprend le dominé lorsqu’il enclenche son processus d’émancipation : ne pas se fier aux idées qu’une personne ou qu’un groupe se fait de lui-même et ne le juger uniquement que sur ses actes. Aimé Césaire a décrit admirablement le rapport social qu’il a appelé « fraternaliste » entre des camarades persuadés être anticolonialistes et lui-même. Cela l’a conduit à ne juger que sur les actes et non sur les professions de foi : « Inventons le mot : c’est du « fraternalisme ». Car il s’agit bel et bien d’un frère, d’un grand frère qui, imbu de sa supériorité et sûr de son expérience, vous prend par la main (d’une main hélas ! parfois rude) pour vous conduire sur la route où il sait trouver la Raison et le Progrès […] Dans ces conditions, on comprend que nous ne puissions donner à personne délégation pour penser pour nous ; délégation pour chercher pour nous ; que nous ne puissions désormais accepter que qui que ce soit, fût-ce le meilleur de nos amis, se porte fort pour nous »
La polémique à propos d’Exhibit B est un analyseur de la tentation fraternaliste encore trop présente à gauche et du refus grandissant de celle-ci par les populations issues de l’esclavage et de la colonisation d’une part et par des militants antiracistes refusant d’occulter la dimension systémique et politique du racisme d’autre part. Elle en annonce de nombreuses autres à chaque fois que le fraternalisme se déploiera dans la sphère artistique ou dans les autres sphères de la vie sociale. C’est une bonne nouvelle pour notre société que l’émergence de ces postures de vigilances collectives, même si cela peut dans un premier temps paraître laborieux aux uns et douloureux aux autres. Seule, la rupture avec le fraternalisme peut créer les bases d’une alliance qui ne soit pas une subordination pour reprendre encore une fois Aimé Césaire[xii] . Le mouvement antiraciste dont nous avons tant besoin aujourd’hui ne pourra pas se construire sans cette alliance qui exclut la subordination.
Le poids des médias lourds
La prestation de Brett Bailley a reçu de nombreux soutiens. L’ensemble des journaux se sont emparés de l’affaire avec une convergence impressionnante des analyses. La logique des différents papiers et reportages est similaire et binaire : les uns seraient antiracistes, pour la liberté d’expression et pour le dialogue ; les autres seraient des censeurs, portés par le ressentiment et partisans de la violence. Il suffit d’observer dans le passé les moments d’une convergence aussi forte pour s’apercevoir qu’ils correspondent à des moments de prises de parole des dominés. Nous avons connus cela dans le soutien à SOS Racisme, au moment des dites affaires du foulard, dans la mobilisation des jeunes des quartiers populaires sur la Palestine ou dans les mobilisations contre les interventions militaires françaises en Afrique. A chaque fois, la parole perturbatrice est stigmatisée et réduite pour ne laisser place qu’à un discours bisounours consensuel. Le second procédé journalistique fortement mobilisé dans la couverture médiatique de la polémique est l’appel à des « spécialistes » sociologues, historiens ou anthropologues qui, par « l’argument d’autorité », viennent porter un jugement. Ce procédé construit les contestataires comme irrationnels, portés par l’émotion irraisonnée et ne se situant que dans la réactivité. L’accusation de « racisme anti-blanc » n’est pas loin et est présente implicitement dans de nombreux articles. Se taire face à ce qui est perçu comme humiliant ou courir le risque d’être construit comme idiot, irrationnel et « raciste anti-blanc », telles sont les deux seules alternatives que laisse la violence symbolique de la scène médiatique dominante.
Le troisième procédé médiatique utilisé fut l’appel au témoignage des spectateurs décrivant tous de manière unanime le caractère antiraciste de l’œuvre. Les spectateurs noirs sont particulièrement appréciés. Il s’agit ici de nouveau de procéder de manière binaire en opposant les « bons » qui témoignent en ayant vu le spectacle et les « mauvais » qui réagissent en n’ayant même pas vu le spectacle. Pour la plupart, ces témoignages parlent d’ailleurs de leurs émotions et nous n’avons aucune raison de les mettre en doute. Mais la question n’est pas là. Les questions posées sont celles de la signification et du message politique de l’œuvre d’une part et celle des effets de ce message dans la société française telle qu’elle est aujourd’hui d’autre part. Force est de constater que cette société reste irriguée par de multiples représentations sociales infériorisantes et de nombreux préjugés hiérarchisants. De surcroît, le contexte de crise et sa conséquence en termes d’augmentation de la « concurrence pour les biens rares » ne font que raviver les unes et les autres.
Enfin, la construction médiatique de l’Afrique et de l’Africain d’aujourd’hui dans le monde médiatique et politique entretient ces images. Ce continent apparaît aux yeux du Français moyen comme celui des guerres « étranges » qui secouent ces continents et que l’on n’explique surtout pas par les intérêts économiques en jeu mais à partir de grille « ethniciste », « tribaliste », « de haines ancestrales », etc. Il apparaît également comme celui de la corruption généralisée, sans relier celle-ci aux donneurs d’ordres qui se trouvent dans les multinationales, en particulier françaises. Il apparaît enfin comme celui des maladies « étranges » dont la propagation fait peur sans les relier à l’état des services de santé détruits par les plans d’ajustement structurel du FMI. C’est ce Français moyen-là qui reçoit le message et non un Français abstrait qui se serait débarrassé par magie de ces représentations et de ces préjugés. Voici le résultat d’une enquête menée au début des années 90 par l’université du Wisconsin, consistant à recueillir les images de l’Afrique et des Africains auprès des étudiants blancs : « L’Afrique est : couverte de jungle ; un grand safari ; tombe en morceaux ; un continent où la famine sévit ; pleine de la guerre ; montée du sida, déchirée par l’apartheid, bizarre, brutale, sauvage, primitive, en arrière, tribale, sous-développée, et noire »
A moins de considérer que la France est préservée de ces images, force est d’être vigilant à la réception des messages concernant l’Afrique et les Africains. Si certains peuvent considérer comme secondaire la réception d’une œuvre, d’autres ne peuvent pas se le permettre, tant sont grandes les répercussions sur leur vie quotidienne.
La polémique autour d’exhibit B est un analyseur des verrous de la pensée qui bloquent l’émergence d’un antiracisme systémique et politique.
* Source : Investig’Action
https://bouamamas.wordpress.com/2014/12/18/exhibit-b-quiproquo-ou-analyseur/#more-118
Sur le discours de la souveraineté_ Patrick Chamoiseau. (Antilla n°719).
Billet pour résister. Sur le discours de la souveraineté.
Voyager avec Antilla n°719 sur l’un des beaux discours-critiques de Patrick Chamoiseau.
La chose aujourd’hui la moins évidente pour tous, est que nous vivions en pays dominé. Pour en juger, nous utilisons généralement une grille de lecture qui date des sombres périodes coloniales et des dominations brutales. Or la donne a changé. La domination est de frappe silencieuse. Insidieuse. Elle rabote l’imaginaire. Elle modélise les valeurs. Elle fait accroire qu’il n’y a rien de mieux, ni d’alternative autre.
Le dominé se sent vivre dans le meilleur schéma possible compte tenu de ses capacités moindres. Etre indépendantiste (tendre à être souverain dans son pays) n’est plus un positionnement politique, mais une éclipse de la conscience; pour le moins un irréalisme. Ainsi, les réalistes dominés deviennent les plus nombreux.
Tu es indépendantiste? Comment feras-tu pour vivre? Que va devenir ce petit pays débile? … etc. Et tous ces questionneurs sont persuadés d’être lucides. Ils se disent libres en oubliant qu’il n’y a pas de liberté sans responsabilité, et surtout sans souveraineté. Ces questionneurs sont des Antillais, mais aussi des amis français le plus souvent progressistes, mais qui installés au pays deviennent sans même s’en rendre compte d’innocents colonialistes, acceptant pour notre pays ce qu’ils’ n’accepteraient en pièce manière pour le leur. Quand le « réalisme » écarte ainsi le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, quand il ne pose pas ce principe comme préalable à tout réalisme politique, économique ou social, à toute ambition de développement, je soupçonne qu’il y a là colonialisme ou auto-colonialisme.
Les indépendantistes sont donc confrontés à une nouvelle forme de domination. Elle touche directement à la perception des choses. Elle introduit dans la conscience et dans l’appréhension du réel, une équation hallucinatoire. Nous sommes accrochés à l’assistanat et à la dépendance comme à une drogue euphorisante. Comme à une chance. Et pire : comme à l’unique destin possible. Il est difficile de lutter contre. Il y a cinquante ans de cela, il était facile de crier au colonialiste et à l’impérialiste. Aujourd’hui, les bottes cloutées et les boutous ont disparus. Nos populations sont préoccupées par des questions de chômage pour eux-mêmes et pour leurs enfants, de précarité, de désorganisation familiale, d’avenir, de protection sociale, de drogues. Toutes inquiétudes qui règnent dans les pays occidentaux développés et que nous éprouvons via un niveau de vie artificiel. Toutes préoccupations vitales qui font passer en second plan la question de notre assujettissement silencieux.
Face à de tels soucis le mot Liberté tombe dans l’ornière du pathos émotionnel. Le discours de souveraineté doit donc-dans un même balan- prendre en charge ces préoccupations et s’attacher à dissoudre l’équation hallucinatoire.
L’équation hallucinatoire se combat sur le terrain de l’imaginaire. Toute force indépendantiste devra s’ériger en force guerrière sur le domaine de l’imaginaire. Le discours de souveraineté sera d’abord un discours culturel et une effervescence créatrice dans tous les domaines, et sur des principes qui sacralisent la diversité contre l’unicité, le diversel contre l’universel, la fête des langues et des cultures dans les métissages des créolisations et des créolités…
Les préoccupations d’époque se combattent par un véritable projet économique et social. Un projet qui soit global, c’est-à-dire qui canalise un maëlstrom de propositions et de créativité dans un sens général contraire à l’assistanat et à la dépendance. Ce sens général suscitant une synergie positive pour l’ensemble. Le discours de souveraineté sera et devra être un projet de société qui tienne compte des mutations du monde.
Et là, on mesure toute la masse d’inertie qu’il nous faut manœuvrer. Il est plus facile d’être de la gauche-gestionnaire ou de la droite-assimiliationniste, ou même de ces désabusés-aigris qui méprisent les indépendantistes pour mieux supporter leur démission et leur mal-être. Le discours de souveraineté demande plus d’effort, plus d’imagination, plus d’audace, plus de crédibilité, qu’à tout autre politique et politicerie du pays. Il est la plus lourde des charges, mais celle-là redresse bien le dos et confère une colonne vertébrale.
Il imagine l’oxygène au creux des asphyxies. La lumière au désespoir des ombres.
La vie têtue dans les morts indolores.
Il demande que nous devenions tous de très réalistes et minutieux rêveurs.
Patrick CHAMOISEAU
(Extraits du n° 719).
Antilla Spécial 30 ans- JUILLET/AOUT 2012
Réflexion sur l’industrie culturelle.
Ne m’appelez pas créole ! Dominique Monotuka. Les Editions MWEN_2006

Cette étude vise à restituer l’origine spirituelle, politique et historique exacte de cette représentation identitaire que constitue l’idéologie créole appelée communément la créolité.
Le créole, le nègre « créole », en effet est précisément une des catégories hiérarchiques d’esclaves que les colons ont inventée pour plus efficacement soumettre les nègres et négresses faits esclaves.
Etre un(e) créole est, d’après la norme esclavagiste, la première hiérarchie identitaire que le nègre et la négresse doivent gravir, de force, pour prétendre obtenir la confiance glorificatrice du« maître » c’est-à-dire pour espérer se prévaloir d’être un(e) bon(ne) esclave auprès de son maître : un nègre ou une négresse relativement docile à l’ordre de domination coloniale établi.
L’oppression coloniale, accompagnée d’amnésie forcée, a été d’une intensité telle, que les descendants des esclaves continuent aujourd’hui encore, à vouloir se glorifier et s’enorgueillir de cette identité d’asservissement, « être un créole ».
Cette vérité, on nous l’avait cachée !
Art, culture et crise économique.
- Manuel Hermia est musicien, philosophe et photographe et réfléchit depuis plusieurs années à la place de l’artiste dans notre société.
La crise économique rend encore plus difficile le financement du secteur culturel, souvent premier champ à être sacrifié sur l’autel de l’austérité. Plus profondément, elle entraîne un renforcement de l’aspect utilitariste de la culture et elle tend à assigner un rôle économique à l’artiste, caractéristique de l’idéologie néolibérale. Comment penser ce phénomène, s’en prémunir et trouver des voies alternatives ?
LE CONSTAT
Ces derniers mois ont été marqués par la remise en question des faibles acquis des artistes au niveau de leur statut social et de leur droit au chômage. Parallèlement à cela, suite aux crises économiques à répétition qui ont engendré en Europe des programmes d’austérité touchant la majorité des États, de nombreuses associations, compagnies, festivals et projets culturels ou socioculturels subventionnés en tout ou en partie par l’État, voient depuis quelques années leurs subventions régulièrement limitées, remises en questions, non indexées, revues au rabais… et ceux qui jouissent d’une augmentation ou qui arrivent à obtenir une nouvelle subvention sont à présent considérés comme des exceptions.
On assiste donc à un phénomène double où la culture, avec d’un côté les artistes qui lui insufflent son âme, et d’un autre toutes les structures qui lui donnent corps, se retrouve de plus en plus affaiblie. Un phénomène affectant aussi le secteur socioculturel. Cet affaiblissement se retrouve encore accentué par la concurrence de fait qui se joue entre la « culture de divertissement » et la « culture pour l’art ». Sans vouloir ici entrer dans un débat qualitatif, on en retiendra surtout que les valeurs économiques prennent de plus en plus de place dans le discours lié à la culture, et que les crises économiques accentuent encore ce phénomène.
UN REGARD LUCIDE SUR LA CULTURE ET SUR NOS SOCIÉTÉS
Dans ce contexte d’austérité générale, il importe de souligner que ce n’est pas parce qu’on nous force à nous accommoder aux conséquences de la crise, que nous sommes obligés de considérer cette austérité comme une fatalité. Au contraire, il nous appartient plus que jamais de garder un point de vue lucide sur notre société, sur ses qualités comme sur ses dysfonctionnements, en même temps que sur le rôle crucial que joue la culture au sein de toute société humaine.
La mission d’une société humaine consiste à garantir la survie de l’ensemble des citoyens, et à les amener à un mieux-vivre en mettant en œuvre une organisation globale. Dans les sociétés modernes, la politique nous aide à organiser les choix de société et les prises de décisions au sujet des problèmes de tous ordres qui se présentent. Quant à l’économie, elle sert à faire circuler les biens tout en permettant les échanges nécessaires à la consommation, à créer des emplois et à générer des profits dont tout ou une partie sera récupérée par l’État pour financer la mise en œuvre des décisions prises pour le bien-être général. Il y a donc un lien étroit entre la politique et l’économie puisque ce sont les profits engendrés via l’économie et les emplois qu’elle engendre, qui donnent à l’État les moyens de mettre en œuvre les programmes définis par la voie politique. À l’origine, l’économie est donc un outil de la politique, et pas l’inverse. Aussi, selon le système politique en vigueur, la nature du système économique variera, et la masse financière dont dispose un État variera de même. De nos jours, ces systèmes, autrefois simplement capitalistes ou communistes, peuvent aussi prendre des formes hybrides. C’est le cas pour certains pays du nord de l’Europe par exemple, qui sont véritablement engagés dans l’économie capitaliste, tout en maintenant de fortes taxations garantissant à l’État la possibilité de répondre à un très large éventail de besoins sociaux. C’est aussi le cas pour la Chine, qui demeure communiste tout en mettant en œuvre une forme de capitalisme d’État.
Quoi qu’il en soit le rôle de l’État demeure central. Tous les acquis sociaux des deux derniers siècles en témoignent, car ils ont marqué un des plus grands progrès de l’Histoire humaine, en bâtissant des sociétés plus justes, capables de mieux répartir les richesses et d’apporter une plus grande sécurité à chaque personne, en mutualisant les soins de santé, les pensions, l’assurance-chômage, etc. Toutes ces choses qui tendent à améliorer nos conditions de vie au quotidien et qui ont permis à nos sociétés de mériter le nom de civilisation.
Mais au cours de cette même période de l’histoire moderne, au fil des décennies, nos sociétés sont passées du capitalisme classique au néocapitalisme. Le capitalisme classique traduisait une idéologie consistant à promouvoir l’esprit d’entreprise et le profit individuel dans la mesure où ils étaient censés irriguer l’ensemble de la société, engendrant ainsi une augmentation de ce bien-être pour tous. Mais le néocapitalisme ne s’encombre plus d’aucune notion d’intérêt général, et se contente d’afficher un but unique : l’enrichissement des investisseurs. Depuis la globalisation entamée dans les années 1970, l’économie s’est progressivement muée en un pouvoir global de nature supranationale, échappant ainsi à toutes les règles nationales édictées par les États. C’est ce caractère supranational du pouvoir économique qui a définitivement déraciné le capitalisme du peu de fonction sociale dont il disposait encore. À partir de là, le capitalisme s’est divisé en deux expressions idéologiques. La première reconnaît l’importance d’un État-providence qui tâche de répondre, au moins partiellement, aux nécessités de la société et de tous ses membres, dans un souci d’équité relative et de bien-être général. Et la seconde, qui tend à réduire l’État à sa plus simple expression, tend à privatiser tous les pans de la société qui peuvent l’être, vidant l’État de sa substance et le subordonnant, comme les individus, aux exigences du seul pouvoir économique.
LES EFFETS DE L’IDÉOLOGIE NÉOLIBÉRALE SUR LA CULTURE
Quel est le rapport de tout ceci avec la culture ?
Suite à cette mutation du système économique, de plus en plus sujet à la spéculation, et déraciné des enjeux locaux, humains et écologiques, le ciment de nos sociétés s’est de plus en plus effrité, mais nous nous y sommes en quelque sorte habitués, car le matérialisme ambiant a fini par imprégner nos systèmes de valeurs. Nous sommes en effet conditionnés à trouver normal que l’économie prime sur nos vies et que les bénéfices du système économique ne soient plus un outil de bien-être à disposition des États, mais seulement un outil d’enrichissement pour des investisseurs privés. Le rôle social de l’économie, en tant que moyen dont les bénéfices servent à être réinjectés dans les services aux citoyens, est même une logique que l’idéologie néolibérale tente à présent de réduire à une caricature des régimes communistes…
Ceci est en tous les cas symptomatique du fait que la primauté absolue de l’économie dans le monde d’aujourd’hui véhicule une idéologie qui tend à imprégner nos valeurs les plus profondes. On pourrait penser que cette affirmation est exagérée, mais voyons ensemble comment cela se traduit dans la pratique. Celle-ci se traduit par deux effets notoires.
a) les facteurs économiques influent sur les démarches artistiques
Dans le secteur culturel, il est frappant de constater que les instances publiques demandent de plus en plus souvent à des acteurs culturels de prouver leur rendement, leur viabilité économique, sans se soucier du fond réel que les œuvres, transformées en « produits » peuvent transmettre.
Arrêtons-nous un instant : la musique, le cinéma, le théâtre, la peinture, la danse, la sculpture, la bande dessinée et la littérature ont-ils pour vocation de nous faire rêver et de nous donner un autre angle de vue sur l’existence, de nous ouvrir des horizons en nous faisant réfléchir et élargir nos points de vue sur la vie ? Ou de faire du chiffre ?
Le sens qui habite les œuvres n’a absolument rien à voir avec ce qu’elles représentent en tant que produits culturels, c’est-à-dire le nombre d’exemplaires ou de tickets d’entrée vendus… Mais aujourd’hui, la primauté de l’économie sur les autres aspects de la vie est telle, que pour certains les résultats de vente dépassent de loin le sens qui habite les œuvres. Le discours sur l’impact économique de l’œuvre, en tant que produit, tend à progressivement supplanter la qualité artistique ou le rôle social de l’art…
Au fil des ans, la qualité de ce discours s’est altérée à tous les étages de la vie culturelle : entre artistes, entre l’artiste et son label, sa galerie, sa compagnie, entre les associations, entre les diffuseurs de spectacle et les organisateurs… Et bien entendu entre les associations et le ministère de la Culture. Il est extrêmement regrettable et choquant de constater que, qu’ils soient de droite ou de gauche, les cabinets de ministre de la Culture sont, d’une façon ou d’une autre, touchés par ces convictions héritées d’une logique ultralibérale, puisqu’ils demandent de plus en plus systématiquement à des projets et des structures avant tout concentrés sur une qualité artistique, de prouver leur viabilité économique. Évidemment, cet axe économique existe, et le secteur culturel a appris à le faire valoir pour prouver qu’il n’est pas seulement un secteur « à la charge » de l’État et qu’il génère tout un champ d’activité économique, mais dans le monde artistique, ce niveau d’importance ne sera jamais comparable à ce que génère le secteur du divertissement.
Tout ceci pour dire que là où certains ont des œillères et ne jurent que par l’argent et la productivité dans l’art, il est aussi possible de voir le signe d’une dérive par rapport au rôle essentiel dévolu à la culture dans une société humaine.
b) la réalité de l’artiste est niée.
Cette idéologie néolibérale a également pour effet d’altérer notre vision du travail. En même temps que commencent à disparaître les principes de solidarité au profit d’un individualisme aveugle, le non-emploi n’est plus envisagé comme une situation dont on est victime mais bien comme une situation dont on est coupable.
C’est donc par le prisme de valeurs néolibérales que l’on tente aujourd’hui de représenter l’artiste comme un assisté et un profiteur du système.
Pour dépasser cette vulgaire caricature de l’artiste au travail, voyons plutôt quelles sont les caractéristiques de sa réalité quotidienne. Les artistes ne sont ni des indépendants ni des ouvriers, ni des employés. Ils échappent de fait aux statuts traditionnels du monde du travail, où les relations sont envisagées selon un mode hiérarchique et une relation basée sur l’exploitation. L’artiste travaille souvent seul, ou alors dans une relation d’interdépendance avec d’autres artistes, il ne travaille donc généralement pas « pour » un autre artiste, mais éventuellement « avec » un ou plusieurs autres artistes. Aussi, l’artiste travaille au projet, ce qui implique qu’il alterne des périodes d’emploi et de non-emploi avec un rythme n’ayant aucune commune mesure avec les métiers traditionnels. C’est donc un travailleur « super » intermittent. Ajoutons encore à cela qu’il cumule souvent plusieurs fonctions et différents savoir-faire, et nous sommes à même de constater que toutes ces différences fondamentales par rapport aux modèles traditionnels du travail engendrent la nécessité de créer un statut qui convienne réellement au monde artistique.
Cependant, le constat est simple : cette nécessité ne trouve pas de réponse adaptée. Les acquis en la matière sont faibles, et aujourd’hui partiellement mis en péril, sous prétexte que certains profitent du système, ou se laissent aller à l’assistanat. Quant à une solution réellement adaptée aux artistes, le fait est que dès que l’on tente d’avancer sur des projets politiques concrets, les partis traditionnels se cabrent systématiquement sur leurs positions et se refusent à sortir d’une logique exploitant/exploité dans laquelle ils restent historiquement engoncés, s’avérant du même coup incapables de commencer à envisager l’existence de statuts intermédiaires échappant à toute logique d’exploitation.
Il y a pourtant là une réalité sociale qui existe bel et bien, même si certains persistent à la nier : de plus en plus d’individus, et pas seulement des artistes, travaillent seuls, dans une certaine indépendance, mais sont liés aux autres par une interdépendance, échappant ainsi à un lien hiérarchique réel et à une logique d’exploitation. On leur demande pourtant de choisir entre un statut d’indépendant inadapté pour eux, et un statut d’employé classique, tout aussi inadapté. La mise sur pied d’un nouveau statut de travailleur est donc bien pertinente, afin que cette réalité propre au monde artistique soit enfin reconnue et puisse servir de base à une redéfinition des conditions d’accès à l’assurance-chômage tout aussi adaptée au secteur en question.
Le fait de nier la réalité de l’artiste constitue ainsi un des étranges penchants de nos sociétés contemporaines. Mais si l’on s’accorde sur le fait que l’art et la culture participent à insuffler un sens et une cohésion au sein d’une société, il n’est pas étonnant que l’idéologie néolibérale tente de s’y attaquer. En effet, la puissance de l’économie supranationale se renforçant lorsque des pays acceptent de limiter leur État-providence au plus strict minimum, il va de soi que le néocapitalisme gagne à affaiblir tout ce qui peut donner de la consistance aux États. La culture, au même titre que la politique sociale ou l’enseignement, fait partie de ces domaines. L’idéologie néolibérale diffuse donc des théories qui nous conditionnent à penser que ces domaines coûtent trop chers à la collectivité et qu’il nous faut progressivement renoncer à les subventionner… pour éventuellement accepter d’en venir à les privatiser…
COMMENT DÉFENDRE LA CULTURE, ET LE SECTEUR CULTUREL ?
Comme on le voit, l’engagement pour la défense du secteur de la culture dans son ensemble, dans le cadre d’une politique culturelle digne d’une société humaniste, ne peut se faire en ignorant que le monde tel qu’il est aujourd’hui est dominé par le pouvoir excessif d’une économie devenue supranationale et dont l’appétit n’a que faire des tissus internes de nos sociétés. Le fait de porter un regard critique sur notre société nous a permis de reconnaître les effets pervers d’une idéologie et d’une politique qui traitent la culture d’un point de vue trop imprégné d’impératifs économiques, et qui traitent les artistes comme n’ayant pas d’existence propre et de statut particulier.
Pour réagir à cela, la première piste qui s’offre à nous consiste à remettre la politique culturelle dans son champ d’action réel, en veillant à ce que les pouvoirs publics continuent à subventionner le secteur culturel sur une base avant tout artistique, et non pas économique, de façon à ce que la société contribue à renforcer le rôle social réel de la culture : véhiculer du sens, distiller du rêve, susciter du questionnement et amener de l’ouverture dans nos vies et nos rapports quotidiens.
Aussi, dès lors que des programmes d’austérité contraignent nos sociétés à des efforts plus importants, il nous faut encore plus veiller à ce que cette priorité au facteur artistique soit maintenue. Mais il convient également de rappeler que s’il n’y a pas de raison pour que le secteur culturel ne soit pas plus épargné qu’un autre ; il n’y a pas de raison non plus pour qu’il subisse plus de pressions que d’autres secteurs.
Enfin, je voudrais terminer en insistant sur le fait que, afin de ne pas toujours parler de la culture d’une façon déconnectée, comme s’il s’agissait d’une île au large de la réalité quotidienne, il importe de revenir à ce type de vision, à la fois philosophique, économique et politique. Car la culture n’est pas isolée de la société. Au contraire, elle constitue le sang du corps social, et elle irrigue chaque partie de ce corps. Il est donc indispensable d’arriver à repenser son existence en tant que telle, tout en tenant compte de l’ensemble des liens qu’elle entretient avec les autres parties de la société.
Une politique culturelle digne de ce nom se doit de repartir d’une réflexion de fond qui dépasse de loin la culture seule, et qui comporte ce type de compréhension transversale. Hélas, la politique telle qu’elle se pratique aujourd’hui dans les hémicycles ne laisse plus beaucoup de place à ces réflexions de fond. Pour défendre la culture et les artistes, dans les années qui viennent, il faudra donc apprendre à se défendre contre un ennemi aussi gigantesque qu’invisible… la domination du matérialisme le plus plat, sous toutes ses formes.
Racisme et culture. Extraits… Frantz Fanon : Pour la révolution Africaine.

- « Étudier les rapports du racisme et de la culture c’est se poser la question de leur action réciproque. Si la culture est l’ensemble des comportements moteurs et mentaux né de la rencontre de l’homme avec la nature et avec son semblable on doit dire que le racisme est bel et bien un élément culturel. Il y a donc des cultures avec racisme et des cultures sans racisme ».
- « En réalité les nations qui entreprennent une guerre coloniale ne se préoccupent pas de confronter des cultures. La guerre est une gigantesque affaire commerciale et toute perspective doit être ramenée à cette donnée. L’asservissement, au sens le plus rigoureux, de la population autochtone est la première nécessité ».
- « La mise en place du régime colonial n’entraîne pas pour autant la mort de la culture autochtone. Il ressort au contraire de l’observation historique que le but recherché est davantage une agonie continuée qu’une disparition totale de la culture pré-existante. Cette culture, autrefois vivante et ouverte sur l’avenir, se ferme, figée dans le statut colonial, prise dans le carcan de l’oppression.
La momification culturelle entraîne une momification de la pensée individuelle. L’apathie si universellement signalée des peuples coloniaux n’est que la conséquence logique de cette opération ».
- « Culpabilité et infériorité sont les conséquences habituelles de cette dialectique. L’opprimé tente alors d’y échapper d’une part en proclamant son adhésion totale et inconditionnelle aux nouveaux modèles culturels, d’autre part en prononçant une condamnation irréversible de son style culturel propre ».
- « La réalité est qu’un pays colonial est un pays raciste ».
- « Or, redisons-le, tout groupe colonialiste est raciste ».
- « En fait le racisme obéit à une logique sans faille. Un pays qui vit, tire sa substance de l’exploitation de peuples différents, infériorise ces peuples ».
- « Le racisme n’est donc pas une constante de l’esprit humain ».
Extraits du texte de l’intervention de Frantz Fanon au 1er Congrès des Ecrivains et Artistes Noirs à Paris, septembre 1956. Publié dans le No Spécial de Présence Africaine, juin-novembre 1956.
Jean Baudrillard : le complot de l’art
Le complot de l’art
Si dans la pornographie ambiante s’est perdue l’illusion du désir, dans l’art contemporain s’est perdu le désir de l’illusion. Dans le porno, rien ne laisse plus à désirer. Après l’orgie et la libération de tous les désirs, nous sommes passés dans le transsexuel, au sens d’une transparence du sexe, dans des signes et des images qui en effacent tout le secret et toute l’ambiguïté. Transsexuel, au sens où ça n’a plus rien à voir avec l’illusion du désir, mais avec l’hyperréalité de l’image.
Ainsi de l’art, qui lui aussi a perdu le désir de l’illusion, au profit d’une élévation de toutes choses à la banalité esthétique, et qui donc est devenu transesthétique. Pour l’art, l’orgie de la modernité a consisté dans l’allégresse de la déconstruction de l’objet et de la représentation. Pendant cette période, l’illusion esthétique est encore très puissante, comme l’est, pour le sexe, l’illusion du désir. A l’énergie de la différence sexuelle, qui passe dans toutes les figures du désir, correspond, pour l’art, l’énergie de dissociation de la réalité (le cubisme, l’abstraction, l’expressionnisme), l’une et l’autre correspondant pourtant à une volonté de forcer le secret du désir et le secret de l’objet. Jusqu’à la disparition de ces deux configurations fortes ¬la scène du désir, la scène de l’illusion¬ au profit de la même obscénité transsexuelle, transesthétique ¬celle de la visibilité, de la transparence inexorable de toutes choses. En réalité, il n’y a plus de pornographie repérable en tant que telle, parce que la pornographie est virtuellement partout, parce que l’essence du pornographique est passée dans toutes les techniques du visuel et du télévisuel Mais peut-être, au fond, ne faisons-nous que nous jouer la comédie de l’art, comme d’autres sociétés se sont joué la comédie de l’idéologie, comme la société italienne par exemple (mais elle n’est pas la seule) se joue la comédie du pouvoir, comme nous nous jouons la comédie du porno dans la publicité obscène des images du corps féminin. Ce strip-tease perpétuel, ces phantasmes à sexe ouvert, ce chantage sexuel ¬ si tout cela était vrai, ce serait réellement insupportable. Mais, heureusement, tout cela est trop évident pour être vrai. La transparence est trop belle pour être vraie. Quant à l’art, il est trop superficiel pour être vraiment nul. Il doit y avoir un mystère là-dessous. Comme pour l’anamorphose: il doit y avoir un angle sous lequel toute cette débauche inutile de sexe et de signes prend tout son sens mais, pour l’instant, nous ne pouvons que le vivre dans l’indifférence ironique. Il y a, dans cette irréalité du porno, dans cette insignifiance de l’art, une énigme en négatif, un mystère en filigrane, qui sait? une forme ironique de notre destin? Si tout devient trop évident pour être vrai, peut-être reste-t-il une chance pour l’illusion. Qu’est-ce qui est tapi derrière ce monde faussement transparent? Une autre sorte d’intelligence ou une lobotomie définitive? L’art (moderne) a pu faire partie de la part maudite, en étant une sorte d’alternative dramatique à la réalité, en traduisant l’irruption de l’irréalité dans la réalité. Mais que peut encore signifier l’art dans un monde hyperréaliste d’avance, cool, transparent, publicitaire? Que peut signifier le porno dans un monde pornographié d’avance? Sinon nous lancer un dernier clin d’oeil paradoxal ¬ celui de la réalité qui se rit d’elle-même sous sa forme la plus hyperréaliste, celui du sexe qui se rit de lui-même sous sa forme la plus exhibitionniste, celui de l’art qui se rit de lui-même et de sa propre disparition sous sa forme la plus artificielle: l’ironie. De toute façon, la dictature des images est une dictature ironique. Mais cette ironie elle-même ne fait plus partie de la part maudite, elle fait partie du délit d’initié, de cette complicité occulte et honteuse qui lie l’artiste jouant de son aura de dérision avec les masses stupéfiées et incrédules. L’ironie aussi fait partie du complot de l’art.
L’art jouant de sa propre disparition et de celle de son objet, c’était encore un grand oeuvre. Mais l’art jouant à se recycler indéfiniment en faisant main basse sur la réalité? Or la majeure partie de l’art contemporain s’emploie exactement à cela: à s’approprier la banalité, le déchet, la médiocrité comme valeur et comme idéologie. Dans ces innombrables installations, performances, il n’y a qu’un jeu de compromis avec l’état des choses, en même temps qu’avec toutes les formes passées de l’histoire de l’art. Un aveu d’inoriginalité, de banalité et de nullité, érigé en valeur, voire en jouissance esthétique perverse. Bien sûr, toute cette médiocrité prétend se sublimer en passant au niveau second et ironique de l’art. Mais c’est tout aussi nul et insignifiant au niveau second qu’au premier. Le passage au niveau esthétique ne sauve rien, bien au contraire: c’est une médiocrité à la puissance deux. Ça prétend être nul: «Je suis nul! Je suis nul!» ¬et c’est vraiment nul.
Toute la duplicité de l’art contemporain est là: revendiquer la nullité, l’insignifiance, le non-sens, viser la nullité alors qu’on est déjà nul. Viser le non-sens alors qu’on est déjà insignifiant. Prétendre à la superficialité en des termes superficiels. Or la nullité est une qualité secrète qui ne saurait être revendiquée par n’importe qui. L’insignifiance ¬ la vraie, le défi victorieux au sens, le dénuement du sens, l’art de la disparition du sens¬ est une qualité exceptionnelle de quelques oeuvres rares, et qui n’y prétendent jamais. Il y a une forme initiatique de la nullité, comme il y a une forme initiatique du rien, ou une forme initiatique du Mal. Et puis, il y a le délit d’initié, les faussaires de la nullité, le snobisme de la nullité, de tous ceux qui prostituent le Rien à la valeur, qui prostituent le Mal à des fins utiles. Il ne faut pas laisser faire les faussaires. Quand le Rien affleure dans les signes, quand le Néant émerge au coeur même du système de signes, ça, c’est l’événement fondamental de l’art. C’est proprement l’opération poétique que de faire surgir le Rien à la puissance du signe ¬ non pas la banalité ou l’indifférence du réel, mais l’illusion radicale. Ainsi Warhol est vraiment nul, en ce sens qu’il réintroduit le néant au coeur de l’image. Il fait de la nullité et de l’insignifiance un événement qu’il transforme en une stratégie fatale de l’image.
Les autres n’ont qu’une stratégie commerciale de la nullité, à laquelle ils donnent une forme publicitaire, la forme sentimentale de la marchandise, comme disait Baudelaire. Ils se cachent derrière leur propre nullité et derrière les métastases du discours sur l’art, qui s’emploie généreusement à faire valoir cette nullité comme valeur (y compris sur le marché de l’art, évidemment).
Dans un sens, c’est pire que rien, puisque ça ne signifie rien et que ça existe quand même, en se donnant toutes les bonnes raisons d’exister. Cette paranoïa complice de l’art fait qu’il n’y a plus de jugement critique possible, et seulement un partage à l’amiable, forcément convivial, de la nullité. C’est là le complot de l’art et sa scène primitive, relayée par tous les vernissages, accrochages, expositions, restaurations, collections, donations et spéculations, et qui ne peut se dénouer dans aucun univers connu, puisque derrière la mystification des images il s’est mis à l’abri de la pensée.
L’autre versant de cette duplicité, c’est, par le bluff à la nullité, de forcer les gens, a contrario, à donner de l’importance et du crédit à tout cela, sous le prétexte qu’il n’est pas possible que ce soit aussi nul, et que ça doit cacher quelque chose. L’art contemporain joue de cette incertitude, de l’impossibilité d’un jugement de valeur esthétique fondé, et spécule sur la culpabilité de ceux qui n’y comprennent rien, ou qui n’ont pas compris qu’il n’y avait rien à comprendre. Là aussi, délit d’initié. Mais, au fond, on peut penser aussi que ces gens, que l’art tient en respect, ont tout compris, puisqu’ils témoignent, par leur stupéfaction même, d’une intelligence intuitive: celle d’être victimes d’un abus de pouvoir, qu’on leur cache les règles du jeu et qu’on leur fait un enfant dans le dos. Autrement dit, l’art est entré (non seulement du point de vue financier du marché de l’art, mais dans la gestion même des valeurs esthétiques) dans le processus général de délit d’initié. Il n’est pas seul en cause: la politique, l’économie, l’information jouissent de la même complicité et de la même résignation ironique du côté des «consommateurs».
«Notre admiration pour la peinture est la conséquence d’un long processus d’adaptation qui s’est opéré pendant des siècles, et pour des raisons qui très souvent n’ont rien à voir avec l’art ni l’esprit. La peinture a créé son récepteur. C’est au fond une relation conventionnelle» (Gombrowicz à Dubuffet). La seule question, c’est: comment une telle machine peut-elle continuer de fonctionner dans la désillusion critique et dans la frénésie commerciale? Et si oui, combien de temps va durer cet illusionnisme, cet occultisme ¬cent ans, deux cents ans? L’art aura-t-il droit à une existence seconde, interminable ¬ semblable en cela aux services secrets, dont on sait qu’ils n’ont plus depuis longtemps de secrets à voler ou à échanger, mais qui n’en fleurissent pas moins, en pleine superstition de leur utilité, et en défrayant la chronique mythologique.
BAUDRILLARD Jean
La fabrique du jazz par ses intermédiaires
Abordant le jazz par ses intermédiaires (journalistes, programmateurs, producteurs, diffuseurs), Olivier Roueff montre comment se constituent en France un genre et une expérience musicale spécifiques, des publics et des goûts différenciés.
Pour en savoir plus :
Olivier Roueff, Jazz, les échelles du plaisir. Intermédiaires et culture lettrée en France au XXe siècle, Paris, La Dispute, 2014. 364 p., 28 €.
http://www.laviedesidees.fr/La-fabrique-du-jazz-par-ses.html
Black power et autogestion
Contre la violente ségrégation, la domination et l’exploitation qu’elle subit, la communauté noire des États-Unis a très tôt, dès la période de l’esclavage, créé ses propres espaces organisationnels et économiques pour résister et survivre. Elle a suivi le long chemin de l’auto-organisation et manifesté une aspiration permanente à gérer ses propres affaires qui s’est incarnée sous des formes différentes en fonction du rapport de force racial et social.
Pour en savoir plus :