La notion de société de consommation désigne un ordre social et économique fondé sur la création et la stimulation systématique d’un désir d’acheter des biens de consommation et des services dans des quantités toujours plus importantes. Pour entretenir la consommation, les biens consommés sont souvent peu durables, ou même sont produits et vendus dans la perspective d’une obsolescence programmée. La consommation tend alors à dominer la morale1. « Relativiser la croissance économique et la consommation » revient alors à rechercher le « bien-vivre »2.
L’expression est souvent utilisée comme critique de la société moderne capitaliste et médiatique, où le court terme, l’image, la possession et la publicité sont devenus des valeurs apparemment dominantes du système économique, au détriment de l’écologie et des relations sociales.
Genèse
Le terme « société de consommation » est la simplification du terme « société industrielle de consommation dirigée », défini par Henri Lefebvre comme étant l’état du capitalisme d’après la Seconde Guerre mondiale (le Salon des arts ménagers en est le fer de lance au milieu des années 1950).
En France, dans les années 70 et singulièrement en Mai 1968 la diffusion de la société de consommation a été pointée : Le philosophe Jean Baudrillard formalise cette mise en cause dans un ouvrage intitulé La société de consommation, dans lequel il estime que la consommation qui était d’abord un moyen de satisfaire ses besoins primaires est surtout devenu un moyen de répondre à une injonction visant à se différencier des autres, tenant lieu de « morale », créant des relations sociales artificielles et de nouveaux symboles (de richesse ou puissance assimilées à l’accumulation de bien) au profit de consortiums de taille croissante, et au détriment de l’environnement, en hypothéquant le futur de l’humanité.
Description du concept
Est qualifiée de société de consommation une société dans laquelle l’achat de biens de consommation est à la fois le principe et la finalité de cette société. Dans celle-ci, le niveau moyen de revenu élevé satisfait non seulement les besoins considérés comme essentiels (alimentation, logement, éducation, santé…) mais il permet aussi d’accumuler des biens (par plaisir, pression sociale ou publicitaire) et de les utiliser ou juste les montrer (pour des raisons esthétiques ou autres), dépenses que certains jugent superflues4. Son symbole est l’objet « consommable » qui s’use et qu’il faut renouveler, voire l’objet jetable. S’il est possible de produire des objets plus résistants, cela augmenterait leur coût et leur durée de vie, ce qui nuirait alors à la consommation.
Critiques théoriques
Pour les opposants à la Société de consommation, l’idéologie consumériste se résume ainsi : il faut sans cesse créer de nouveaux désirs et le remède à tous ces désirs est de les assouvir. Et pour assouvir ses désirs, il faut gagner suffisamment d’argent pour pouvoir se le permettre. Cela suppose que, dans cette idéologie, tout est mercantilisable et que tous les désirs (sous influence publicitaire) et les efforts finissent par être constamment orientés vers un seul et unique horizon : la consommation.
Certaines critiques insistent sur le fait que cette focalisation sur les biens matériels pose un problème moral et philosophique pour le consommateur, une question concernant la finalité de l’Homme et de la vie terrestre.
D’autres critiques insistent sur les implications concrètes de la consommation, à travers ce qu’elle implique en termes de production, transport et distribution. La comparaison du niveau de consommation finale avec la capacité terrestre de production de ressources naturelles et d’absorption de la pollution a conduit à l’émergence du concept de surconsommation. L’économiste Daniel Cohen souligne que si la Chine avait le même nombre de voitures par habitants que les États-Unis, elle consommerait la totalité de la production pétrolière mondiale, où que si elle avait la même consommation par habitant, elle devrait utiliser l’ensemble des forêts de la planète. Le mode de développement occidental n’est donc pas généralisable à l’échelle planétaire aussi bien d’un point de vue écologique que de disponibilité des ressources5.
Sur le plan philosophique, la recherche de bien matériels, quête sans fin, pousserait également selon certains au phénomène de surconsommation et s’interrogent sur la différence entre fin et moyens dans notre existence.
Sur le plan scientifique, on évoque l’empreinte écologique de notre consommation : l’essentiel de nos déchets n’est pas traité, certaines ressources naturelles sont en effet épuisées ou en voie de l’être et l’agriculture intensive est un facteur de réduction de la biodiversité.
Sur le plan psychologique, le consumérisme peut entraîner une continuelle frustration (encouragée par les modèles, les jalousies et les désirs alimentés par la publicité) qui engendre mal-être et parfois les comportements agressifs qui en découlent.
Sur le plan social, lorsque la consommation devient la valeur centrale de la société, l’être humain peut devenir lui aussi un « produit » qui doit « savoir se vendre » et qui doit entrer « en concurrence », « en guerre », avec tous et autrui. La cohésion sociale et les valeurs humaines sont alors mises au second plan lorsque ce principe s’applique sur fond de crise économique et sociale entraînant une pression et une détresse morale, voire un isolement social, que même la consommation ne parvient pas à atténuer.
Un autre aspect social est le paradoxe d’Easterlin lié au paradoxe de l’abondance : le bonheur généré par une richesse plus élevée est éphémère, au bout de deux ou trois ans 60 % de la satisfaction liée à celle-ci disparait. Le Bonheur intérieur net stagne malgré l’accumulation des richesses. Selon Daniel Cohen, « ce sont les augmentations de la richesse qui sont le déterminant du bonheur, pas son niveau, quel que soit celui-ci », ce qui donne deux interprétations : soit la consommation est semblable a une drogue, demandant sans cesse des nouveautés à consommer ce qui va à l’encontre des limites écologiques, soit elle est liée à la théorie des « sentiments moraux » développé par les économistes Adam Smith et Albert Hirschman, basé sur la nécessité d’être reconnu par les autres, par vanité et rivalité, impliquant un perpétuel dépassement d’autrui5.
Mouvements critiques
La critique de la société à orientation consumériste est une critique du « tout quantitatif » (productivisme, standardisation, esprit de concurrence agressive) au détriment de la « diversité qualitative » (biodiversité, développement durable, valeurs et dignité humaines, qualité de vie) lorsque la consommation devient alors une finalité en soi, un projet de société au lieu d’être un moyen.
Parmi les principaux mouvements critiques de la société de consommation, citons principalement les altermondialistes (altermondialisme) et leur célèbre slogan « le monde n’est pas une marchandise », une bonne partie des mouvements écologistes (écologisme) ainsi qu’une partie des partis politiques de la gauche qui en critiquent certains aspects.
À ceux-ci s’ajoutent des acteurs critiques qui s’intéressent aux aspects plus particuliers de l’impact de la société de consommation tels que l’excès de publicité dans le paysage (mouvement antipub, associations contre la publicité abusive, la publicité mensongère ou le sexisme dans la publicité).
Apparu plus récemment, le mouvement des décroissants (décroissance), notamment, fait valoir le fait qu’une économie basée sur une croissance exponentielle continue de biens matériels régulièrement renouvelables et l’encouragement à la consommation au-delà des besoins raisonnables, et dont une bonne partie de la production non achetée est jetée, n’est pas compatible avec les limites de la biosphère et l’échéance écologique que représente le réchauffement climatique et proposent de réfléchir à de possibles alternatives viables.
Discussion
La société de consommation a permis l’accès à de nombreux biens et services à un grand nombre d’êtres humains, mais dans un monde fini, elle s’est accompagnée d’une consommation croissante de matière, d’énergie et de ressources difficilement/coûteusement renouvelables. La consommation croissante, voire la surexploitation de ressources naturelles est sources d’une crise environnementale mais aussi énergétique et climatique6.
La société de consommation est le socle autour duquel le monde se construit. La société de consommation sert de vecteur a la société Occidentale. Depuis internet le monde peut voir l’opulence des sociétés Occidentales, nécessairement cette opulence fera naître dans l’esprit du pauvre indien un sentiment de jalousie. Du côté de l’occident nous avons des peuples poussés dans l’opulence par la publicité qui fait naître des faux besoins a ceux qui n’ont plus de besoin. L’injustice du capitalisme c’est que ceux qui ont de vrais besoin n’ont pas accès a la consommation tandis que l’on crée de faux besoins a ceux qui n’en ont plus. La solution c’est la mondialisation. D’une part elle permet aux consommateurs occidentaux de déléguer les taches laborieuse aux pays émergents et d’autre part de consommer des produits moins coûteux car produit par une main d’oeuvre moins cher. Ainsi en Chine par exemple, une classe moyenne de consommateur émerge déjà, et la Chine commence elle aussi a rechercher une main d’oeuvre moins coûteuse en délocalisant en Afrique, en Éthiopie par exemple. L’enjeu de ce phénomène n’est pas seulement le développement économique, la croissance de tout les pays du monde, la société de consommation tend a remplacer la culture nationale par la culture de marque. Peu à peu les cultures nationales sont oubliées, remplacés par l’identité de marque commerciale. Ce mécanisme de destruction des cultures nationales a pour objectif de faire de l’être humain un être universel portés sur la consommation, ne s’identifiant non plus a une culture nationale, une histoire nationale mais bien a une marque commerciale. Ce but de l’universalisation de la consommation est de réduire les différences économiques et identitaires entre les pays, car des voisins identiques s’entendent toujours et la promesse de la paix dans le monde pourra advenir. Ainsi le 20es et ses deux guerres mondiales ne sera plus qu’un mauvais souvenir. Par contre, nous serions en train d’encourager une conception étriquée de l’humain et de ses valeurs fondamentales, nous serions en train d’échanger notre identité pour du matérialisme en quantité industrielle entraînant l’épuisement de nos ressources naturelles.
Dans l’art
La société de consommation, apparue dans le monde dans les années 1960 a été dénoncé par plusieurs artistes, tels que Erro avec son œuvre Foodscape ou Arman avec La Grande Poubelle.
Le réalisateur italien Pier Paolo Pasolini a déclaré à ce sujet : « Je suis profondément convaincu que le vrai fascisme est ce que les sociologues ont trop gentiment nommé la société de consommation7 ».
En 2010, l’artiste Damien Saez dénonce, par l’affiche de son album J’accuse, la société de consommation.
Source : wikipédia
Erro, « Foodscape », 1962, peinture glycérophtalique sur toile, 200 x 300 cm.Musée d’art moderne de Stockolm.
Cette image, peinte à partir d’un collage de photographies publicitaires, organise les aliments selon les lois de la perspective. Devant cette accumulation panoramique de produits alimentaires appartenant au quotidien des americains , le spectateur oscille entre la fascination pour l’abondance et la répulsion pour le goût stéréotypé de cette nourriture industrielle.
![[cml_media_alt id='980']Erro_ Foodscape[/cml_media_alt]](http://www.anbabwa-arts.fr/wp-content/uploads/2014/08/Erro_-Foodscape.jpg)

![[cml_media_alt id='980']Erro_ Foodscape[/cml_media_alt]](http://www.anbabwa-arts.fr/wp-content/uploads/2014/08/Erro_-Foodscape.jpg)
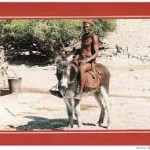
![[cml_media_alt id='851']Vieil indien[/cml_media_alt]](http://www.anbabwa-arts.fr/wp-content/uploads/2014/08/Vieil-indien-104x150.jpg)
